
En 1933, Odette du Puigaudeau et Marion Sénones, deux Parisiennes qui voulaient voyager et vivre leur amour librement, embarquèrent pour la Mauritanie. En 2019, Catherine Faye et Marine Sanclemente, journalistes, sont parties sur leurs traces. Récit de leur voyage.
Partir à l’aventure ensemble et écrire à quatre mains. Ce projet nous tenait à cœur. Ensuite, le hasard – mais le hasard existe-t-il ? – nous a mises sur le chemin de nos aventurières. En 2018, sur le présentoir d’un bouquiniste des quais de Seine, un livre daté de 1936, Pieds nus à travers la Mauritanie, a attisé notre curiosité. Spécialistes de l’Afrique, nous savions peu de choses sur ce pays, deux fois grand comme la France, à 90% désertique et trait d’union entre le Maroc et le Sénégal. Conquises par le témoignage des deux voyageuses, Odette du Puigaudeau et Marion Sénones, nous n’avons pas hésité à nous glisser dans leurs pas pendant deux mois, entre septembre et octobre 2019. Tour à tour en bateau, à pied, à dos de chameau, en 4x4, nous avons suivi le même tracé, de Nouadhibou à Nouakchott, en passant par Ouadane, sur plus de 2000 kilomètres. Et dans les mêmes conditions, malgré la fragilité géopolitique de la zone sahélienne. Cet ancien protectorat français devenu République islamique nous a d’abord déboussolées, puis fascinées, avant de nous conquérir. Récit des coulisses de notre voyage.
Une organisation au cordeau
Pas facile de traverser, en huit semaines, toutes les régions de la Mauritanie sillonnées par Odette et Marion en trois années de périples mis bout à bout. Il a fallu condenser leurs trois expéditions en une seule, et imaginer un parcours cohérent. Une boucle, longeant la côte du nord au sud, puis, vers l’est, à l’intérieur des terres, pour repartir ensuite vers le nord. Il aurait certes été héroïque de partir seules à l’assaut du désert. Mais nous avons préféré prendre contact avec deux guides-interprètes mauritaniens (Mamine et Sidi), qui ont joué le rôle de fixeurs (pour les rencontres sur place), de traducteurs auprès des nomades et de chauffeurs. Avec eux, via Whatsapp, nous avons dessiné le trajet et étudié les contraintes logistiques.
La partie la plus délicate de l’organisation, notre méharée de trois semaines en autonomie dans le Sahara, était un défi. Pas question d’y aller à l’aveugle comme nos deux aventurières, chaque détail avait une importance vitale. Après avoir éliminé toutes les affaires superflues pour limiter le poids de notre sac à dos à 8 kilos, il a fallu calculer les quantités de provisions : pour chaque personne, cinq litres d’eau par jour et environ un kilo de céréales (riz, mil, blé, orge…) pour l’ensemble du voyage, plus une vingtaine de boîtes de conserve au total. Les chameaux croulaient sous le poids des toiles des khaïmas (tentes traditionnelles), piquets, bidons, couvertures et autres sacs de nourriture. Parfaitement adaptés au désert, ils peuvent certes porter jusqu’à trois cents kilos chacun, mais difficile de ne pas s'apitoyer sur leur sort.
Périlleuse frontière
Après deux avions entre Paris, Casablanca et Dakhla (situé au Sahara occidental et de facto sous administration marocaine), et un trajet de huit heures à bord d’un bus déglingué, nous avons atteint la frontière entre le Sud du Maroc et le Nord de la Mauritanie début septembre. Ne pouvant arriver par la mer comme Odette et Marion, qui avaient embarqué en France, nous avons été obligées de passer par cette région géopolitiquement complexe.
Après le départ des Espagnols en 1976, le Maroc et la Mauritanie se sont partagés le Sahara occidental. Mais un mouvement indépendantiste sahraoui, le Front Polisario, s’est opposé à l’annexion, et occupe toujours militairement cette partie du globe. Les deux pays sont donc aujourd’hui séparés par une zone tampon de quatre kilomètres... où aucune loi ne s’applique.
Sur place, le décor est apocalyptique : une terre aride et désertique, où des montagnes de déchets côtoient des pneus éclatés et des voitures abandonnées, sous le mouvement ondulant des drapeaux de la République arabe sahraouie démocratique. Quarante minutes sur un sentier caillouteux sillonnant au milieu des mines, sous une chaleur de plomb, avec un sac à dos lourd, et sans vivres… Nous ne sommes pas prêtes d’oublier l’éreintante et inquiétante traversée de ce territoire sans statut officiel.
Régime nomade
Dès notre arrivée sur le sol mauritanien, après le passage de la frontière, nous avons été initiées au cérémonial du thé vert. Partagé cinq à dix fois par jour, il rythme les journées et précède tous les repas. Sous les tentes des nomades, il est parfois accompagné de dattes et d’arachides, le rituel n’a pas disparu au fil des décennies. Sur une photographie retrouvée dans des archives, Odette semble se délecter de lait de chamelle. Contrairement à nous, les deux voyageuses s’en accommodaient.
Pour elles, comme pour nous, les dîners échangés avec les familles chez qui nous faisions des haltes, parfois pour y dormir, étaient l’occasion de s’immerger dans la vie et les traditions. Certains mets étaient un régal, comme les couscous de dromadaire, les méchouis d’ovins ou les louksours, des sortes de crêpes aux légumes. D’autres s’avéraient, en revanche, plus déroutants, tels les pattes de cabri ou les pénis de bouc.
Entre soif et épuisement
Pour organiser notre périple, nous étions tributaires des délais d’écriture pour la parution de notre livre L’Année des deux dames, en septembre 2020. Notre départ ne pouvait donc se faire que début septembre. Une période encore très chaude… Dès le passage de la frontière, la chaleur accablante, atteignant parfois plus de 50° C, est devenue notre pire adversaire. Nous n’imaginions pas que ces quatre premiers kilomètres à pied entre le Maroc et la Mauritanie seraient un prélude à la soif, omniprésente. Une obsession qu’il a fallu apprendre à contrôler et à gérer, car nous n’avions pas assez d’eau et nous voulions éviter de trop puiser dans les maigres ressources des nomades. « La faim, nous la connaissions, ce n’est rien ; mais la soif, c’est la mort, et la vie devient précieuse lorsqu’elle est si précaire », témoigne Odette à l’époque, n’hésitant pas, avec sa compagne, à boire l’eau croupie d’un marigot.
Il fallait également supporter les douleurs dans les jambes. Avec la rétention d’eau, nos pieds étaient souvent gonflés. Nos mains aussi. Et puis la poussière et les tempêtes de sable ont déclenché des crises d’asthme chez l’une, une épine d’acacia a provoqué une nécrose sous le pied de l’autre.
Sans compter la fatigue. Pendant les trois semaines de méharée, nous parcourions chaque jour entre vingt et trente kilomètres à pied et à dos de chameau. La sensation d’épuisement s’ajoutait à l’inconfort matériel et alimentaire, et au manque d’intimité.
Quant à la toilette, nous savions qu’elle serait limitée, mais qu’importe dans le désert ? « Apaisement qui vient de son vide, de sa stérilité, de sa quasi-inutilité. Son sable sec, ses cailloux, son ciel incolore, tout vous dit que l’effort est inutile – et que la sagesse est de se résigner devant le ”non” du destin », témoigne Odette. De sages paroles.
Paysages lunaires
Certains imaginent, à tort, que le désert est vide, alors qu’il foisonne de beautés. De l’infiniment petit aux paysages sans fin. « Qu’on ne cherche pas d’autre but à ce récit que d´évoquer la simple poésie, la grandeur sobre du Sahara, et le charme parfois amer de nos longues courses incertaines. » Cette citation de nos héroïnes nous a portées de bout en bout. Que ce soit sur les remous de l’Atlantique, à bord de notre lanche, à moins d’un mille du majestueux banc d’Arguin et des nuées de flamants roses. Ou, une fois à terre, dans la brousse changeante. Plate, vallonnée, brutale, parfois végétale, à chaque fois plus surprenante.
Une multitude de formations géologiques se dispute les vastes étendues inhabitées. Sur les plateaux fracturés du Tagant, près de Ouadane, on se croirait même sur la Lune ! Dans le silence de la structure de Richat, une énigme géologique de 50 kilomètres de diamètre surnommée « l’œil de l’Afrique », le temps semble s’être arrêté. On se sent projeté dans le Crétacé. Face à l’océan de dunes de l’erg Ouarane, qui s’étend sur près de 800 km à cheval entre la Mauritanie, l’Algérie et le Mali, quelle sensation de liberté !
Dans le Sahara, on ne vit pas la nature, on est la nature. Faire corps avec elle est d’ailleurs le meilleur moyen pour endurer les conditions rudes. Scarabées, araignées blanches, scorpions, vipère des sables, gerboises… à l’ombre des acacias du désert, toute une vie s’offre au regard.
La nuit, sous la voûte céleste inondée d’étoiles, allongées dans nos sacs de couchage à même le sable, on entendait glapir le fennec, le chacal... Chaque jour, la route était un émerveillement. Ici des pommiers de Sodome (dont les fruits ressemblent à de petites pommes ovales), là des figuiers d’enfer, des coloquintes, des jujubiers… Les noms font rêver, mais les plantes sont parfois redoutables. Piquantes, allergisantes. On finit par s’habituer, la symbiose avec la nature se produit dès lors qu’on lâche prise. Comme l’évoquaient nos deux aventurières un siècle avant nous, cette communion a quelque chose « des temps bibliques ».
Sous les pluies diluviennes
En voyage, la nature a souvent le dernier mot. En 1936, alors qu’Odette et Marion prévoyaient de rejoindre l’Azalaï - cette grande caravane de plusieurs milliers de chameaux qui traverse deux fois par an le désert du Sahara - des pluies diluviennes les ont immobilisées pendant quatre mois dans le Tagant, au cœur de la Mauritanie.
Nous n’avons pas eu cette malchance. Toutefois, notre périple nous a permis de prendre conscience des changements climatiques qui affectent le pays et le quotidien de ses habitants. Il y a bien sûr la sécheresse croissante, qui a brûlé la plupart des palmiers dans le désert, mais les violentes tempêtes sont aussi plus fréquentes. Nous pensions y avoir échappé, c’était sans compter sur le déchaînement brutal de la nature.
Le dernier soir de notre méharée, nous avions dîné dans un décor magique, près de la palmeraie d’Azoueiga. Soudain, le vent s’est levé, un souffle violent a retourné les tentes, l’orage s’est mis à gronder… Il a fallu réagir vite, nous nous sommes réfugiées dans le pick-up et Sidi, notre chauffeur, a pris le volant. La pluie était si intense, qu’il conduisait à l’aveugle. Évitant de justesse un précipice, il a fini par s’arrêter, et nous avons terminé la nuit dans la voiture, tant bien que mal. Au petit matin, quelle stupeur : l’oued, qui était asséché la veille, était devenu un fleuve, large de plus de dix mètres ! Et, à seulement un mètre de l’eau, les traces de nos pneus ! On peut dire que notre voyage s’est déroulé sous une bonne étoile.




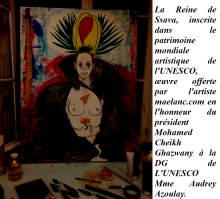



.png)
.png)
.png)
.png)
.png)